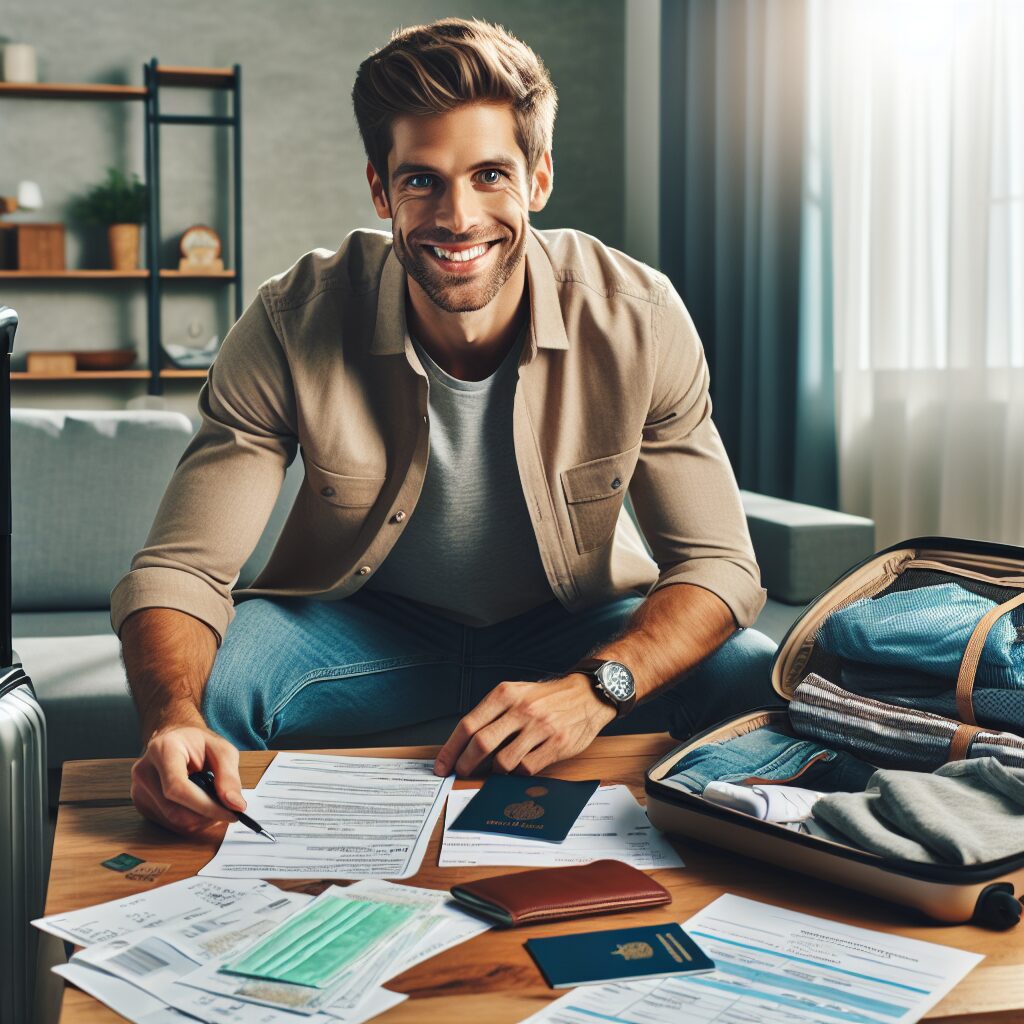Ces dernières années ont été marquées par des évolutions significatives concernant les droits des salariés en arrêt maladie. Un sujet particulièrement sensible est celui des voyages à l’étranger durant cette période de congé. En effet, suite à des décisions importantes du Conseil d’État et de la Cour de cassation, les règles ont été modifiées de manière à simplifier certaines démarches administratives.
Un changement de cap pour les voyages à l’étranger
Historiquement, la législation imposait aux salariés en arrêt maladie d’obtenir une autorisation préalable de leur Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) avant d’entreprendre un voyage hors des frontières. Cette réglementation était en vigueur depuis l’arrêté du 19 juin 1947 et visait à s’assurer que le contrôle médical puisse être correctement effectué, garantissant ainsi une administration rationnelle des indemnités journalières versées aux malades.
Un cas particulier a provoqué un tournant décisif. Un salarié en temps partiel thérapeutique avait décidé de partir à l’étranger sans autorisation, ce qui lui valut la suspension des indemnités journalières. Cet incident aboutit à une contestation juridique, la Cour de cassation sollicitant l’avis du Conseil d’État sur la légalité de cette exigence.
La décision du Conseil d’État de 2024
Le verdict tombe le 28 novembre 2024 : l’obligation d’une autorisation préalable est jugée illégale au regard de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. Ce dernier stipule que les seules obligations du salarié sous indemnités journalières sont de respecter les prescriptions médicales et de se soumettre aux contrôles requis. En d’autres termes, rien n’impose légalement de solliciter la permission de la CPAM pour un départ à l’étranger.
Cette décision a été suivie par un arrêt de la Cour de cassation le 5 juin 2025 confirmant que le refus d’indemnisation fondé sur une absence d’autorisation préalable n’était pas justifié légalement.
Les obligations qui subsistent
Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant une totale liberté d’action pour les salariés concernés. Les obligations quant au respect des contrôles médicaux demeurent inchangées. Par exemple, se soustraire volontairement à ces vérifications peut toujours entraîner la suspension des prestations. Ainsi, un voyage qui empêcherait le passage d’un contrôleur au domicile pourrait poser problème, même si le départ avait reçu l’aval du médecin traitant.
Un cas emblématique illustre ce point : une assurée partie en Tunisie durant son arrêt maladie a dû rembourser près de 2000 euros d’indemnités, après qu’un contrôle à son domicile n’a pu être effectué. La Cour de cassation, bien que reconnaissant l’accord médical obtenu avant le départ, a insisté sur l’irrévocabilité des contrôles, dont l’absence peut justifier la suspension des paiements.
Les bonnes pratiques à adopter
Face à ces nouvelles règles, certaines précautions s’imposent aux salariés désirant voyager à l’étranger durant leur arrêt maladie. Tout d’abord, il demeure prudent de tenir informée sa CPAM de tout déplacement envisagé, même si cette démarche n’est plus juridiquement requise. Cette transparence peut éviter des malentendus et montrer de bonne foi.
Ensuite, il est recommandé de conserver des traces écrites de toutes les communications : accord du médecin, certificats de voyage, etc. Enfin, privilégier les destinations où un retour rapide serait envisageable en cas de convocation pour un contrôle médical est une sage précaution.
Vers une gestion plus souple des arrêts maladie
Ces évolutions témoins d’une volonté d’assouplir les contraintes administratives témoignent d’une prise de conscience quant à l’importance du bien-être des salariés, même lorsqu’ils sont en arrêt de travail. Les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation représentent une avancée notable pour la liberté des salariés, dans le respect des devoirs essentiels liés à leur état de santé.
En conclusion, si voyager à l’étranger durant un arrêt maladie est désormais plus accessible, il demeure essentiel de ne pas négliger les obligations légales qui garantissent le bon déroulement des contrôles médicaux indispensables au maintien des prestations.