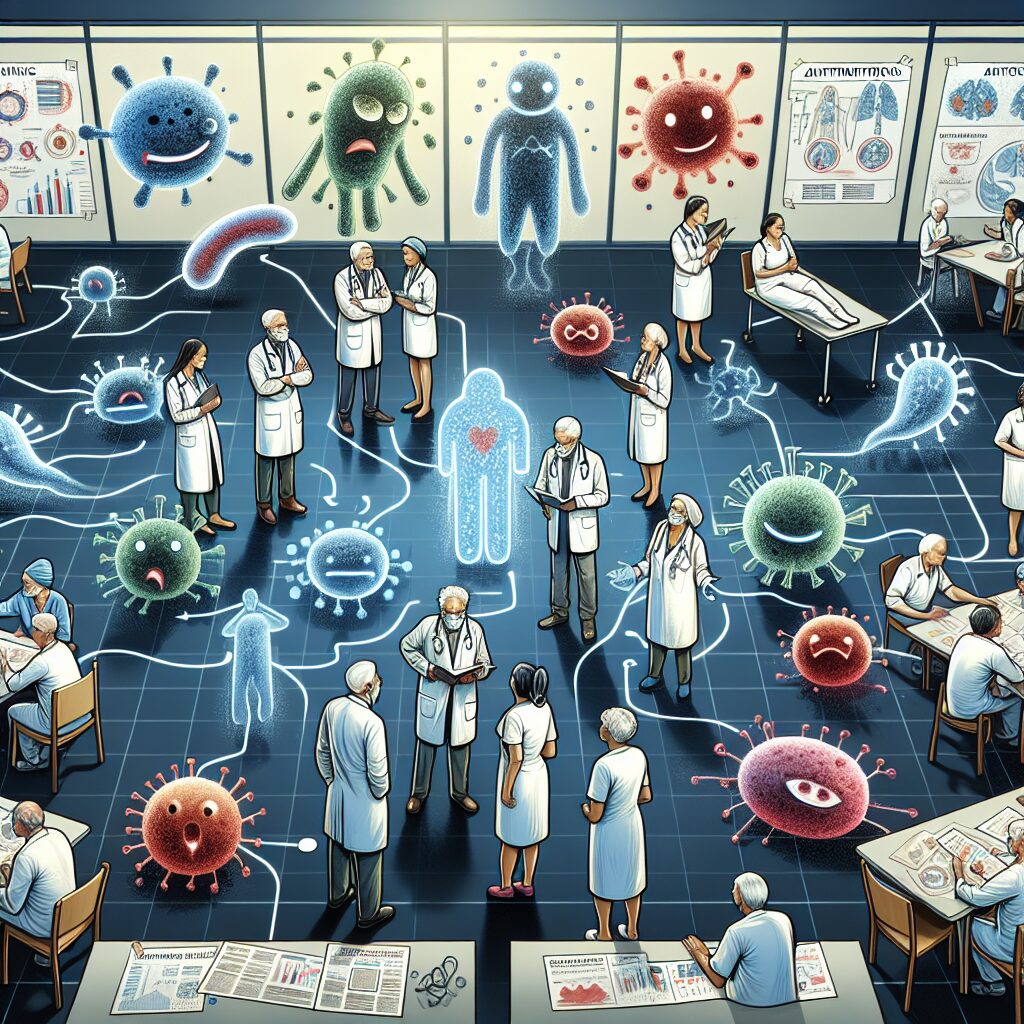Les récentes conclusions de l’enquête nationale de prévalence 2024, menée par Santé publique France, éclairent la scène des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en termes d’infections associées aux soins (IAS) et de traitements antibiotiques. Cette étude essentielle met en lumière des avancées notables dans la réduction des infections, soulignant l’implication croissante des structures d’accueil et du personnel médical dans la sécurité sanitaire des résidents.
Un cadre d’étude rigoureux et inclusif
Depuis 2010, un réseau européen coordonné par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), encourage la conduite d’enquêtes visant à surveiller les infections dans les Ehpad en France. En 2024, cette enquête a été orchestrée par Santé publique France avec la collaboration du Réseau de prévention des infections et de l’antibiorésistance (RéPIA) et les Centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias).
Avec la participation de 1 288 Ehpad répartis sur le territoire français, représentant plus de 102 000 résidents, l’enquête a réussi à mobiliser la moitié des établissements incités à y prendre part, imprimant un tableau encourageant de 52 % de participation. Un nombre considérable d’établissements participant volontairement montre une conjugaison significative d’efforts vers une amélioration continue de la gestion du risque infectieux.
Principaux résultats : Une diminution rassurante des IAS
Les résultats de 2024 présentent une baisse encourageante de la prévalence des infections associées aux soins par rapport à 2016. La prévalence observée est de 2,35 %, représentant un résident sur 40 affecté par une infection durant un jour spécifique, comparé au chiffre de 2,93 % noté précédemment.
Les infections les plus souvent recensées concernent les voies respiratoires (36,2 %), suivies des infections urinaires (31,7 %) et cutanées (25,8 %). Parmi les résidents les plus à risque, ceux âgés de 85 ans et plus, ayant été récemment hospitalisés, en fauteuil roulant, alités, ou porteurs d’escarres, la présence d’infections reste plus marquée.
Focus sur les germes détectés
Les investigations microbiologiques ont permis d’identifier Escherichia coli, Proteus mirabilis et Klebsiella pneumoniae comme les germes prédominants pour les infections urinaires documentées. Cette identification précise facilite le ciblage des thérapies antibiotiques appropriées, contribuant à une meilleure gestion des ressources thérapeutiques.
Stabilité dans les traitements antibiotiques
Le taux de prescription d’antibiotiques montre une stabilité, avec un léger ajustement par rapport aux résultats de 2016. En 2024, 2,87 % des résidents ont été traités avec des antibiotiques, mettant en lumière l’importance d’une surveillance accrue du bon usage de ces médicaments.
Le rôle crucial de l’expertise thérapeutique et de la réévaluation régulière des traitements se révèle indispensable. Malgré une progression dans les prescriptions prophylactiques, désormais à 22 %, la nécessité d’améliorations constantes dans la gestion des traitements curatifs et des pratiques hygiéniques reste patente.
Vers l’amélioration de la prévention des risques infectieux
Face aux défis persistants liés à la prévention des infections, l’étude 2024 préconise le renforcement de certaines mesures comme la documentation plus systématique des infections et la formation approfondie des prescripteurs. Des efforts ciblés sont nécessaires pour formaliser des procédures rigoureuses de réévaluation des antibiothérapies, afin d’éviter la dérive vers une résistance accrue aux traitements.
En faveur d’une gestion efficiente des infections et de l’utilisation des antibiotiques, Santé publique France insiste sur l’importance d’accroître l’accès à des experts en hygiène et à des référents en antibiothérapie au sein des Ehpad. De telles actions contribueront largement à maîtriser et prévenir les situations critiques découlant d’infections mal contrôlées.
L’importance de la mobilisation collective
La réussite de l’enquête tient largement à la mobilisation des équipes soignantes, des prescripteurs et des responsables d’établissements qui, par leur engagement, ont permis d’obtenir une vision claire des priorités à adresser. Ce travail doi mutualisé autour de la surveillance et de l’amélioration de la qualité des soins démontre la force d’une approche communautaire dans la gestion des soins de longue durée.
Pour aller de l’avant, la prise en compte des particularités régionales dans l’élaboration des stratégies de gestion et de prévention se présente comme un axe majeur d’amélioration. Cela inclut le développement d’initiatives éducatives et pratiques spécifiques qui adressent les défis uniques auxquels font face les différentes régions.
En conclusion, ce pas vers une réduction des infections associées aux soins souligne l’importance des efforts conjugués à différents niveaux pour optimiser la santé et la sécurité des résidents en Ehpad, marquant ainsi un jalon important vers l’adoption de pratiques de prévention et de traitement mieux ajustées et efficaces.