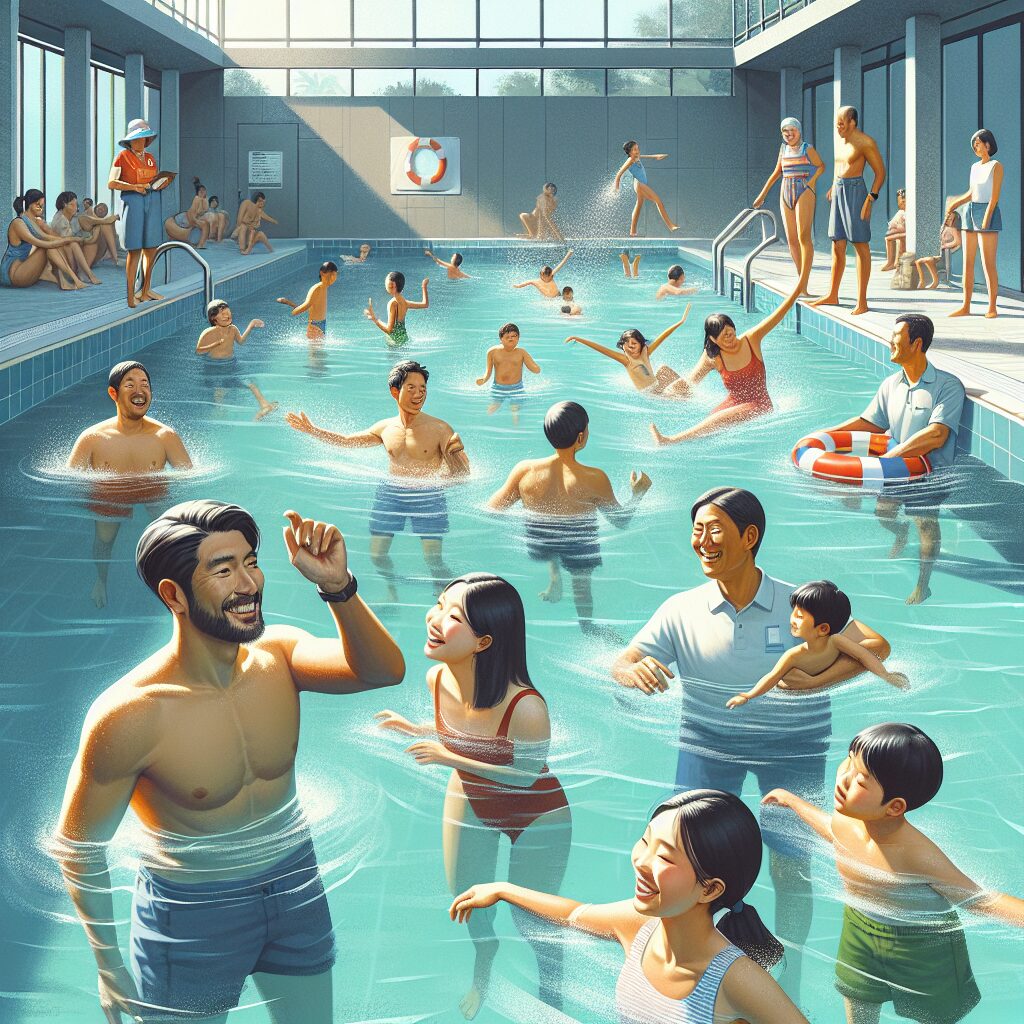Dans un tournant significatif pour l’entretien des piscines publiques, le gouvernement a récemment promulgué un décret supprimant l’obligation de vidange annuelle de ces installations, une réglementation en place depuis 2016. Ce changement s’inscrit dans une démarche de rationalisation des coûts et de minimisation des fermetures, tout en assurant la qualité de l’eau grâce à un contrôle régulier par les agences régionales de santé (ARS).
Jusqu’à présent, les piscines publiques étaient tenues de procéder à une vidange annuelle, une mesure qui, bien que favorisant l’hygiène, engendrait également des coûts élevés et des durées de fermeture importantes. À la lumière des récentes recommendations de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses), cette obligation a été jugée superflue, surtout après les épisodes de sécheresse de 2022 qui ont mis en exergue la nécessité de solutions plus flexibles.
Un ajustement basé sur la qualité de l’eau
La stratégie désormais adoptée est celle des vidanges « au cas par cas », basée sur les résultats des contrôles de qualité de l’eau menés par les ARS. Cette approche vise à ne procéder à des vidanges complètes que lorsque la qualité de l’eau ne peut être garantie par les traitements habituels. Elle concilie ainsi efficacité et économie, conformément aux attentes des collectivités gestionnaires de piscines publiques, qui soutiennent majoritairement cette réforme.
Marina Ferrari, ministre des Sports, a souligné que cette décision n’est pas une mesure d’assouplissement des standards sanitaires. Au contraire, elle renforce l’idée que les vidanges doivent être effectuées lorsque des situations spécifiques le justifient, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources en eau et financière.
Les préoccupations des professionnels et des usagers
Malgré l’optimisme affiché par le gouvernement, le Syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs (SNPMNS) exprime son inquiétude quant à la suppression de la vidange annuelle obligatoire. Pour ces professionnels, la vidange régulière des bassins est essentielle pour maintenir un standard d’hygiène, car les traitements ordinaires ne peuvent compenser le renouvellement intégral de l’eau.
Ils soulignent que l’eau stagnante peut, même traitée, accumuler des substances indésirables, rendant l’air difficilement respirable à cause des chloramines. Le SNPMNS insiste sur le fait que les robots nettoyeurs, bien qu’efficaces pour l’entretien systématique, ne remplacent pas la surveillance directe qui permet de détecter les déficiences structurelles potentielles.
Une décision alignée avec les objectifs écologiques
Ce réajustement réglementaire s’intègre dans un cadre plus large d’économie d’eau. En réduisant le nombre de vidanges, les collectivités espèrent non seulement diminuer les dépenses mais également participer activement à une gestion durable des ressources hydriques. Ce nouveau modèle, en plus de ses bénéfices économiques, est perçu comme une réponse aux défis environnementaux contemporains.
Les agences régionales de santé, garantes de la qualité de l’eau, sont appelées à jouer un rôle central dans cette nouvelle organisation. Elles continueront à effectuer des contrôles réguliers et à déterminer le besoin éventuel d’une vidange, sur la base de critères rigoureux et transparents.
L’avenir des piscines publiques
Cette évolution des pratiques pourrait également ouvrir la voie à l’innovation dans le traitement et la filtration de l’eau. Des solutions technologiques avancées pourraient être déployées pour maximiser la qualité de l’eau et minimiser l’impact environnemental. Les gestionnaires de piscines se voient ainsi encouragés à explorer des options telles que les systèmes de purification ultraviolette ou ionique, qui promettent une désinfection efficace sans nécessité de renouvellement d’eau massif.
En conclusion, la suppression de l’obligation de vidange annuelle des piscines publiques marque une transition vers une gestion plus flexible et efficiente, en phase avec les préoccupations économiques et environnementales actuelles. Néanmoins, la vigilance reste de mise pour assurer que ces changements ne compromettent pas la santé des usagers. Cette réforme ouvre un débat important sur l’équilibre entre efficacité économique, préservation des ressources naturelles et protection de la santé publique.