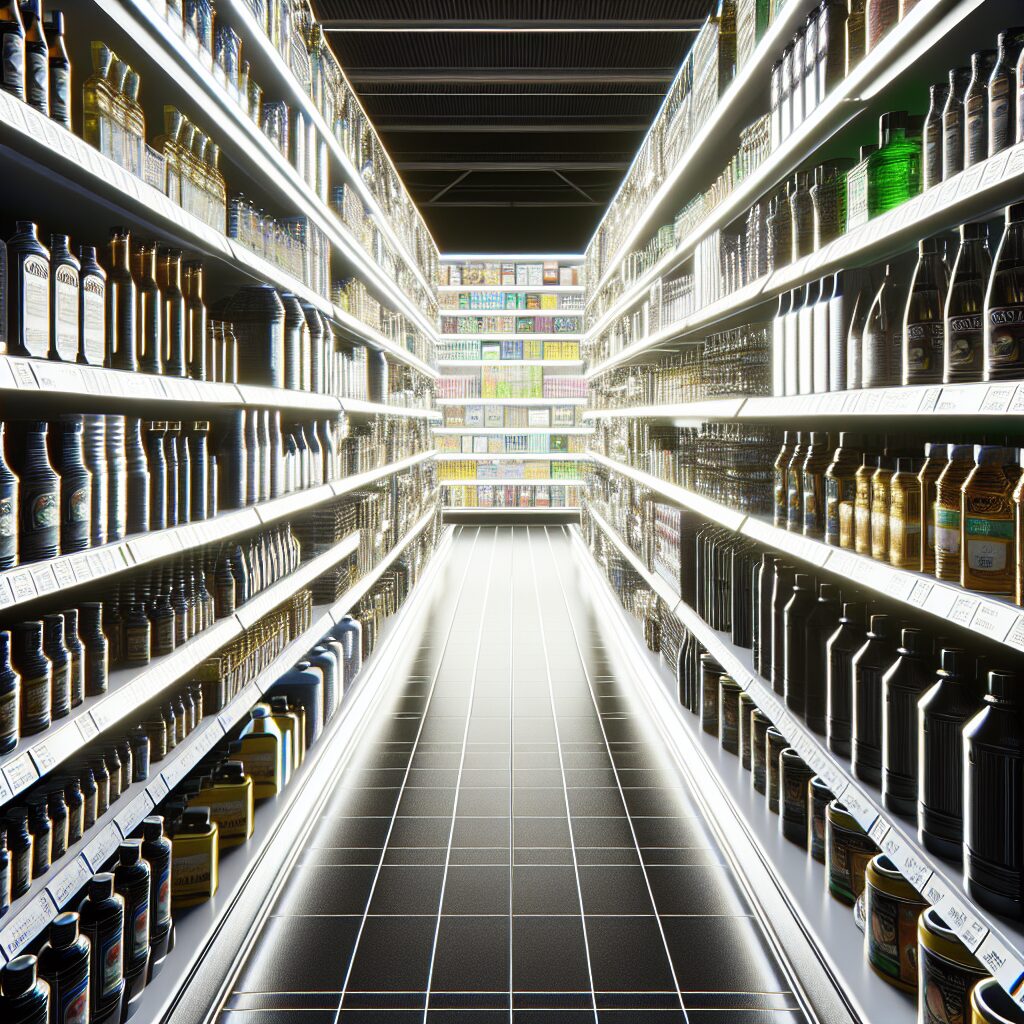Les médecins et scientifiques ne cessent d’alerter sur les dangers de l’hexane, un solvant largement utilisé par l’industrie agroalimentaire. Ce composé chimique, issu de la distillation du pétrole, est massivement employé pour extraire les huiles végétales telles que celles de soja, de tournesol et de colza. Si son utilisation est courante, ses effets sur la santé n’en demeurent pas moins préoccupants. L’hexane est en effet reconnu comme un neurotoxique avéré, ayant des effets dommageables sur le système nerveux et reproducteur, et classé comme perturbateur endocrinien.
Un appel à l’action des professionnels de santé
Face à de telles preuves scientifiques, une trentaine de professionnels de la santé, dont des médecins et chercheurs, ont uni leurs voix dans une tribune publiée pour exiger des mesures rigoureuses. Ils souhaitent voir l’exposition à cette substance réduite voire totalement éliminée. Leurs revendications font suite à une augmentation alarmante des maladies neurodégénératives et des troubles endocriniens dans la population française. Ces affections représentant déjà une part substantielle des coûts couverts par l’Assurance Maladie.
Le collectif propose de remettre en question les niveaux de seuils autorisés en hexane dans les produits alimentaires. Leur objectif est de pousser les autorités à interdire ce solvant ou à le remplacer par des alternatives plus sûres, telles que les méthodes d’extraction mécaniques ou celles utilisant des matériaux biosourcés qui sont couramment adoptées dans l’agriculture biologique.
L’hexane, un contaminant dans nos assiettes
Les professionnels de la santé soulignent un problème de taille : la présence de résidus d’hexane dans un large éventail de produits alimentaires. Une étude récente de Greenpeace a mis en lumière la détection de ce solvant dans 36 produits alimentaires testés, incluant des huiles, du beurre, des laits et du poulet. Bien que ces niveaux ne dépassent pas les seuils légaux actuels (fixés à 1 mg/kg), ils sont jugés obsolètes et basés sur des études scientifiques datant de plusieurs décennies.
Découvrez les alternatives possibles
Les signataires de la tribune insistent sur le fait que le recours à des alternatives est non seulement possible mais nécessaire. Les méthodes d’extraction mécaniques, par opposition à l’utilisation de solvants, représentent une voie prometteuse. Ces techniques, déjà utilisées dans la production d’aliments biologiques, garantissent une extraction sans résidu chimique. De même, les alternatives biosourcées et biodégradables sont encouragées, car elles offrent une viabilité économique et écologique tout en préservant la santé publique.
En outre, cette mobilisation a été renforcée par le rehaussement du classement de l’hexane à « neurotoxique avéré » par l’Agence européenne des produits chimiques en 2024. Ce rehaussement reflète une meilleure compréhension scientifique des risques associés à une exposition prolongée, notamment en matière de santé neurologique et reproductive. En France, cet enjeu devient crucial alors qu’une mission d’information parlementaire est prévue pour approfondir ces questions.
Enfin, une prise de conscience nécessaire
Les consommateurs, eux aussi, ont un rôle à jouer. La transparence sur la présence de substances chimiques dans les aliments est essentielle. Une sensibilisation accrue du public quant aux choix alimentaires et à l’origine des produits peut contribuer à réduire la demande pour des produits contenant des solvants potentiellement nocifs.
Le Groupe Hexane Récalcitrant (GHR), constitué d’experts, continue de soutenir la recherche sur des méthodes alternatives et de promouvoir des normes de sécurité alimentaire plus strictes. En conclusion, cette conjoncture exige une vigilance accrue et une révision des pratiques industrielles en vogue, pour garantir que les compromissions sur la sécurité sanitaire ne se fassent pas au détriment de la santé publique.
La question de l’hexane ne se limite pas à un simple débat technique ou environnemental, mais s’inscrit bien dans une problématique de santé nationale. Une action collective, rapide et coordonnée reste indispensable pour que les assiettes des Français se détachent d’une contamination sournoise et préoccupante.